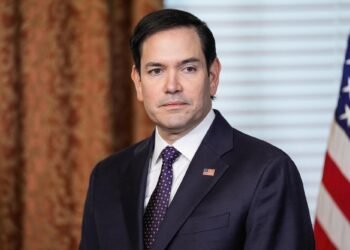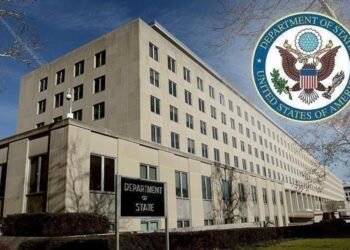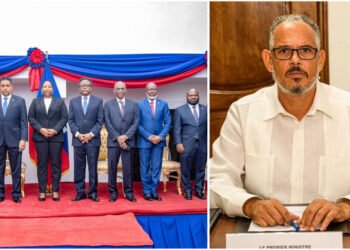Depuis la promulgation de la Constitution impériale du 20 mai 1805, toutes les constitutions d’Haïti prescrivent au président le devoir d’être le garant de la légalité institutionnelle de l’État et du respect des droits des citoyens. À cet égard, nonobstant la destitution ou la démission d’un élu du pouvoir exécutif, la protection de la vie d’un président en fonction devrait être un a priori de toutes les initiatives politiques visant à moraliser la gouvernance publique en Haïti. Cependant, plusieurs chefs d’État ont été assassinés au pouvoir : Jean-Jacques Dessalines, Sylvain Salnave — qui fut l’objet d’un procès expéditif —, Cincinnatus Leconte, Vilbrun Guillaume Sam et Jovenel Moïse. Et, malgré ces crimes contraires aux prescriptions légales et constitutionnelles, aucune action en justice n’a jamais abouti au jugement et à la condamnation des auteurs impliqués dans ces attentats contre la sûreté de l’État.
Cette impunité tend à banaliser la fonction présidentielle en Haïti et sur la scène diplomatique internationale. D’autant plus que cette culture politique de l’insignifiance des symboles nationaux ne favorise guère la construction de la fierté nationale chez un peuple haïtien toujours en quête d’un impératif d’appartenance politique et nationale dans sa lutte pour préserver la souveraineté instaurée par l’épopée de 1804. Comment alors, dans un moment d’introspection nationale, expliquer la répétition d’un fait social, politique et historique qui pose un dilemme : d’un côté, les enjeux du choix des dirigeants nationaux, et de l’autre, le devoir du peuple de se débarrasser de ceux qui violent ses droits fondamentaux à la tête de l’État ?
Le divorce entre la pensée et l’action politiques est à l’origine des drames nationaux. Pour gouverner la cité idéale décrite dans La République, Platon exige un gouvernant philosophe, c’est-à-dire un dirigeant dont la science du gouvernement importe s’il veut gouverner pour le bien de tous. Mais plus encore que la science du pouvoir, la science des vertus — que la philosophie nomme éthique — doit être le bien suprême dans l’âme de celui qui décide au nom de la collectivité.
Or, quelle certitude peut-on avoir de la nature humaine d’un individu pour affirmer qu’il est le meilleur de ses semblables, et qu’il n’abusera pas du pouvoir qu’il détient ? On sait que le pouvoir corrompt, et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Ce problème du choix du meilleur des hommes, fondé sur une nature humaine commune à tous, est un dilemme kantien résolu dans la proposition de l’impératif moral : chaque être humain, pour agir de manière responsable envers soi-même et sa communauté, doit s’imposer des devoirs moraux dans la vie privée comme dans la vie publique. Ainsi, l’éducation vertueuse prônée par Platon, Aristote et Spinoza devient une obligation familiale et étatique, car la cité vertueuse ne peut exister qu’en raison des vertus pratiquées par ses citoyens.
Cependant, cette philosophie politique ne pouvait guère s’accorder avec la société postcoloniale et esclavagiste née en 1804, dont l’évolution fut conditionnée par des luttes de fractions motivées par l’appât du gain et des privilèges.
La mort de Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Cincinnatus Leconte, de Vilbrun Guillaume Sam et de Jovenel Moïse s’explique par des facteurs similaires dont le dénominateur commun fut le partage injuste des richesses nationales. Sans tomber dans un parallélisme excessif, on peut rapprocher une citation de Dessalines d’une autre de Jovenel Moïse, qui aimait paraphraser le martyr du 17 octobre 1806. Face à l’oligarchie terrienne qui voulait s’approprier toutes les terres, Dessalines affirma : « Et les Noirs dont les pères et les mères sont en Afrique, n’auront-ils rien ? Les terres doivent appartenir à ceux qui ont versé leur sang pour l’indépendance. » Tandis que Jovenel Moïse répétait sur un ton ironique mais populiste : « Ti rès la se pou pèp la. »
Ces paroles traduisaient une même revendication de justice face à l’injustice historique d’élites haïtiennes qui se sont arrogé le monopole illégitime des richesses nationales, tandis que la majorité peinait à survivre. De même, Sylvain Salnave, en déclarant : « Par ma peau je suis noir et par mes cheveux je suis mulâtre », résumait le combat contre la hiérarchie raciale héritée de la colonie et prônait un populisme au service des masses urbaines et rurales.
Ainsi, assassiner un président en fonction a souvent été un réflexe politique d’élites menacées dans leurs intérêts par les revendications populaires. Ce réflexe ne dépendait pas nécessairement de la sincérité idéologique du chef de l’État : il pouvait viser un dirigeant populiste, même sans action concrète contre les injustices. Du régime impérial de Dessalines aux présidences de Salnave, Leconte ou Moïse, le fond du problème reste la lutte pour le pouvoir et les privilèges, plus que le changement social.
Les limites d’une nation caractérisée par l’analphabétisme et l’inculture politique expliquent aussi la prise d’otage de l’activité politique par une classe dirigeante corrompue et une bourgeoisie dénuée de nationalisme. La participation dramatique à des élections biaisées, souvent encadrées par la communauté internationale, alimente des institutions dominées par des hommes et des femmes étrangers à toute éthique de conviction et de responsabilité, selon la théorie wébérienne. Les séquelles du système esclavagiste, dans une société privée de thérapie collective par l’éducation, la culture et les arts, ont favorisé l’émergence de chefs tyranniques et de citoyens aux comportements de marrons. D’où des habitus politiques fondés sur la ruse, la méfiance et la survie, qui empêchent la défense des valeurs suprêmes de la politique. Ainsi, la justice n’est pas perçue comme une exigence collective ; les crimes contre un président, comme ceux commis contre des citoyens ordinaires, échappent à la revendication populaire et à l’indignation nationale.
La régression de la nation haïtienne, de l’assassinat de Dessalines à celui de Jovenel Moïse, s’explique par son indifférence envers la justice, pourtant condition de toute grandeur nationale. Quand la morale sociale et les mœurs politiques deviennent incapables de protéger celui que la Constitution désigne comme garant des libertés individuelles, le crime contre un homme d’État — comme contre un simple citoyen — ne suscite plus qu’indifférence et mépris, tant au niveau national qu’international. Le peuple haïtien reste alors l’objet de la compassion du monde, mais non de son respect.
Pour conclure, il est urgent de redonner à la justice sa place suprême dans les habitudes sociopolitiques de la nation haïtienne. Si, comme l’explique Thomas Hobbes dans Le Léviathan, le peuple a le droit de déclencher une révolution pour destituer un président qui a perdu sa légitimité, il n’en demeure pas moins que la justice doit retrouver, juger et condamner les coupables de tout assassinat politique. La présidence doit demeurer la fonction la plus sécurisée et la plus respectée par les institutions régaliennes et par le peuple haïtien tout entier. Ce principe n’exclut pas, bien au contraire, le devoir civique de rejeter tous ceux qui usurpent le titre de président par des mécanismes électoraux frauduleux — condition essentielle pour restaurer la dignité démocratique de la nation.
Soutenez Hebdo24 : pour une information libre et fiable.
Faire un don